Présentation des Axes de recherche
Accueil Présentation de l'équipe Axes
de recherche Publications Programme
des enseignements
Liens favoris Localisation Les bons plans de Montpellier
|
Les modes
d’organisation et de gestion des connaissances en mémoire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La dynamique du
souvenir |
|
|
|
|
|
|
![]()
PROJET
SCIENTIFIQUE DU LABORATOIRE
Que l’on s’intéresse aux
processus perceptifs à l’origine de toute cognition, aux processus
d’acquisition sans lesquels il n’existerait pas de permanence des objets, aux
processus de compréhension, car un stimulus n’est pas seulement traité il est
également compris, tous ces processus sont sous la dépendance des contraintes
exercées par la mémoire, qu’il s’agisse de ses contenus, de ses capacités ou de
ses caractéristiques fonctionnelles. Dès lors, pour nous, un stimulus (image,
mot, phrase ou texte) n’est pas assimilable à ses caractéristiques physiques,
il est, par essence, empreint des cognitions (connaissances et croyances) que
le Sujet possède sur lui et du contexte dans lequel il apparaît. En d’autres
termes, nous nous intéressons à ce que la mémoire ajoute aux sensations pour
former la représentation que nous avons d’un objet, pris au sens large.
Pour rendre compte du contenu,
de l’organisation et du rôle joué par les connaissances en mémoire, on a eu
recours à la notion de schéma (on a
pu parler de prototype : Rosch, 1978 ; de cadre : Minsky,
1975 ; de script : Schank & Abelson, 1977 ; de modèle de
situation : van Dijk & Kintsch, 1983 ou de modèle mental :
Johnson-Laird, 1983). Chaque fois que le sujet est exposé à un stimulus qu’il
doit traiter, un schéma serait activé, ce qui permettrait à ce stimulus de
s’insérer dans ce schéma et, par conséquence, d’acquérir un sens.
Il existe au moins deux façons
d’appréhender la nature et les mécanismes qui régissent un schéma : une
approche strictement symbolique (cognitiviste) qui suppose que le schéma est
stocké en tant que tel en mémoire, une approche sub-symbolique (connexionniste)
qui ne présuppose pas l’existence d’un schéma directement stocké en mémoire.
Pour l’approche symbolique, ce
qui est stocké en mémoire correspond à un ensemble d’éléments signifiants. Ces
éléments forment un ensemble qui peut laisser des places vides pour des
éléments à mémoriser ultérieurement. Ces éléments sont reliés entre eux de
façon stable et occupent un espace mémoire spécifique.
Pour l’approche
sub-symbolique, les éléments conservés ne sont pas directement signifiants et
les objets conceptualisés, à un moment de l’activité, le sont par une
combinaison particulière des éléments primitifs qui peuvent être recomposables
de manière multiple. En définitive, ce qui est stocké en mémoire correspond à
un ensemble de forces de connexion qui une fois activées reconstruisent tout ou
partie des liens existants lors d’une précédente activation et intéressent tout
ou partie des éléments précédemment impliqués.
En d’autres termes, dans
l’approche symbolique on a affaire à une organisation stable d’éléments en
mémoire qui, activée, fournit des réponses cohérentes avec les schémas
stockés ; dans l’approche sub-symbolique à chaque activation les éléments
en mémoire sont réorganisés en fonction des entrées et du contexte, les
réponses fournies étant plus ou moins conformes aux schémas. Ainsi, on parlera
d’instanciation de schémas dans le cadre symbolique et d’émergence de schémas
dans le cadre sub-symbolique.
A l’heure actuelle, il
n’existe pas de données suffisamment établies pour pouvoir privilégier une
approche plus qu’une autre, d’autant que suivant la nature de l’objet étudié
(verbal vs non verbal) chacune d’elle
pourrait être plus ou moins capable de rendre compte des comportements
observés. Nous considérons qu’en matière de mémoire humaine ces deux approches
sont complémentaires et qu’une approche à la fois symbolique et sub-symbolique
pourrait s’avérer plus heuristique.
A travers les objets étudiés
(images, mots, phrases, textes) et les processus cognitifs que nous
privilégions (perception, acquisition, compréhension), nous montrerons que
l’acte de connaissance est un processus émergent des contraintes exercées par
la structure et la nature de l’objet à connaître, le contexte dans lequel se
produit cet acte de connaissance et les contenus de mémoire.
Chaque fois que nous
sollicitons notre mémoire nous n’avons pas forcément le sentiment que les
contenus de mémoire récupérés appartiennent au passé, bien que la mémoire ait
toujours affaire avec le passé. Quand les contenus récupérés n’engendrent pas
un sentiment relatif au passé c’est qu’il s’agit d’habitudes ou d’habiletés, la
mémoire sollicitée correspond au système mnésique appelé « mémoire
procédurale ». Quand le sentiment du passé existe, c’est que les contenus
récupérés sont relatifs à des savoirs conceptuels ou attestés, dans ce cas,
c’est le système mnésique appelé « mémoire sémantique » qui a été
sollicité. Mais pour être vécu comme un souvenir, un contenu de mémoire doit
entretenir un lien étroit avec le sujet en étant situé dans un contexte
temporel, spatial et personnel. Le système de mémoire sollicité correspond à la
« mémoire épisodique ».
Ainsi, suivant que la dimension
épisodique est prise en compte ou non nous aurons affaire à une mémoire
naturelle, par opposition à une mémoire rationnelle, qui s’apparente aux
mémoires artificielles dont se préoccupe l’Intelligence Artificielle. Une
mémoire naturelle intègre à la fois des connaissances (savoirs avérés), des
croyances (savoirs subjectifs) et des données contextuelles (environnement et
état dans lesquels se trouvait le sujet) alors qu’une mémoire rationnelle
n’intègre que des connaissances.
Si l’étude de l’acquisition,
de la gestion et de la récupération des connaissances est nécessaire à la
compréhension de la mémoire humaine, nous considérons que la mémoire humaine
implique plus que le simple recouvrement de connaissances, elle est souvenir.
Les souvenirs humains sont des réminiscences, dans un contexte donné, de la
façon dont nous avons traité connaissances et croyances, non des répliques de
ces connaissances et croyances. Les travaux que nous avons réalisés et ceux que
nous projetons devraient nous permettre d’évaluer la pertinence de cette
affirmation.
![]()
Axe de recherche I :
Les modes d’organisation et de
gestion
des connaissances en mémoire
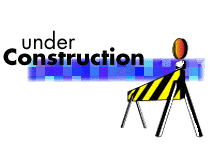
Axe de
recherche I :
Thématique par chercheur
Denis Brouillet
Marie-Christine Gély-Nargeot
Guy Labiale
Manuel Jimenez
Michel Launay
Nathalie Blanc
Isabelle Boulze
Anne-Michèle Graton-Giami
Arielle Syssau
Henri Lehalle
Jean-Marc Lavaur
Pascale Maury
Catherine Monnier
José Moragues
Brigitte Leroy-Viemon
Sylvie Zérillo
Gérard Olivier
Fanny De La Haye
Sophie Martin
Amélie Teisserenc
Kevin Chapuy
Gilles Reilhac
![]()
Axe de recherche II :
La dynamique du souvenir
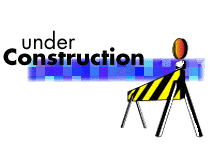
Axe de
recherche II :
Thématique par chercheur
Denis Brouillet
Marie-Christine Gély-Nargeot
Guy Labiale
Manuel Jimenez
Michel Launay
Nathalie Blanc
Isabelle Boulze
Anne-Michèle Graton-Giami
Arielle Syssau
Henri Lehalle
Jean-Marc Lavaur
Pascale Maury
Catherine Monnier
José Moragues
Brigitte Leroy-Viemon
Sylvie Zérillo
Gérard Olivier
Fanny De La Haye
Sophie Martin
Amélie Teisserenc
Kevin Chapuy
Gilles Reilhac
![]()